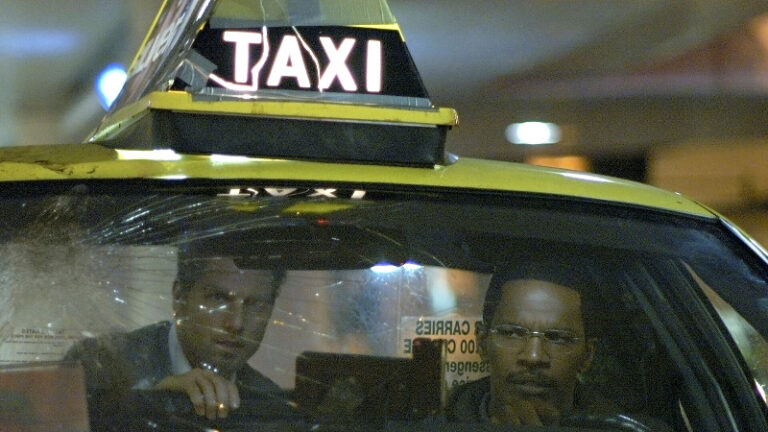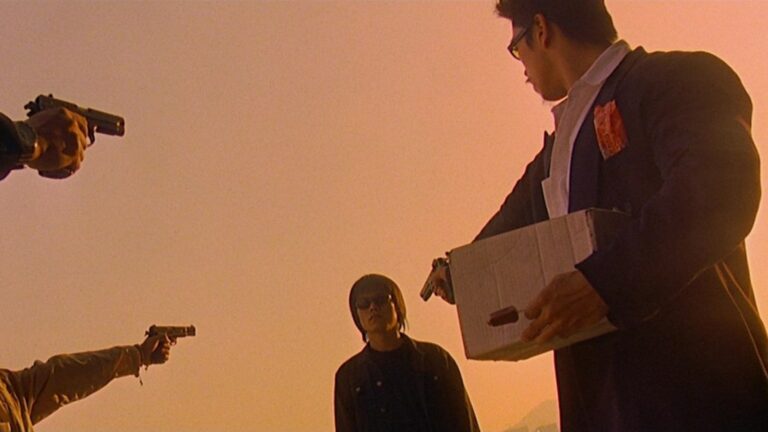La singularité des Incorruptibles ne réside pas seulement dans son équilibre parfait entre film de commande et prolongation de l’univers de Brian De Palma. En 1987, le cinéaste sortait d’une série de films cultes où ses obsessions s’étaient solidement cristallisées : Pulsions, Blow Out, Scarface et Body Double. Sur le papier, le projet et la personnalité de son réalisateur semblaient difficilement compatibles : un biopic doublé d’un film de gangsters, formaté pour un large public, confié à un auteur souvent perçu comme « voyeuriste et sentimentaliste ». Pourtant, De Palma, maître incontesté du cinéma stylisé, a su imposer sa patte, orchestrant un véritable choc en « maître du temps et de l’espace » qu’il était alors de façon incontestable. Rappelons de toute façon que, durant de nombreuses années, Brian De Palma a régné en maître sur le septième art américain, s’imposant alors même au sommet du cinéma dans son ensemble.
L’histoire : A Chicago durant les années trente, lors de la prohibition, Al Capone règne en maître absolu sur le réseau de vente illégale d’alcool. Décidé à mettre un terme au trafic et à confondre Al Capone, l’agent Eliot Ness recrute trois hommes de confiance, aussi intraitables que lui. Ensemble, les quatre « incorruptibles » partent en guerre contre le gang de Capone…
« J’ai joué le rôle d’illustrateur de luxe pour la Paramount et pour le producteur Art Linson, apportant surtout des idées visuelles au scénario du dramaturge David Mamet. » Lire ces mots de Brian De Palma sur Les Incorruptibles a quelque chose de surprenant, tant il semble impossible de ne pas être saisi par cette sentimentalisation exacerbée de l’œuvre, caractéristique de son cinéma, sublimée ici par une mise en scène d’une rare sophistication. Certes, on pourrait croire que cette sentimentalisation s’intègre naturellement à la commande qu’était ce projet, sur lequel la Paramount fondait de grands espoirs. Mais une signature stylistique aussi affirmée, au sein d’un film de studio, paraît inconcevable dans le Hollywood contemporain. D’ailleurs, c’est bien ce système qui a fini par lasser De Palma, au point qu’il clame désormais : « J’en ai fini avec Hollywood ! » Pourtant, Les Incorruptibles demeure, à bien des égards, d’une radicalité hallucinante. Certes, le récit épouse les conventions du classicisme hollywoodien — un héros incorruptible, véritable boussole morale, affrontant un gangster à l’aura légendaire —, mais sa mise en scène en fait bien plus que viser le simple divertissement calibré. À sa sortie, la presse cinéphile s’est empressée de pointer les approximations historiques du film. Quel procès d’intention incroyable ! C’est précisément ce mépris récurrent que l’on retrouve chez toute une frange de la presse, qu’elle soit d’époque ou contemporaine, face à l’essence même du cinéma : la force et la puissance de la mise en scène.

Il est essentiel de le marteler d’emblée : oui, Les Incorruptibles est un pur De Palma, un film de cinéma total, tour à tour violent, décomplexé, grave, sentimental, formaliste, et même, dans une certaine mesure, expérimental… mais aussi d’une scène à l’autre drôle puis soudainement frontal. Aujourd’hui, il ferait figure d’anomalie au sein des productions de studio, où tout semble conçu pour gommer, lisser, voire annihiler la moindre empreinte stylistique d’un cinéaste.
Avant toute chose, Les Incorruptibles est la résultante du métissage entre actionner et western, où les flics traquent et neutralisent des gangsters vêtus de costumes Armani. D’ailleurs, la légende veut que Robert De Niro ait fait appel aux anciens tailleurs d’Al Capone pour concevoir ses tenues dans le film (allant jusqu’à porter des caleçons fait par lesdits tailleurs). Cette lutte acharnée entre les forces de l’ordre et le crime organisé passe inévitablement par les armes, comme l’annonce d’ailleurs et d’emblée le carton d’introduction : « 1931 : Grenades et mitraillettes ont seules force de loi. » L’ombre de Sam Peckinpah plane sur le film, notamment dans les ralentis iconiques sur les tirs de shotgun lors de la paroxystique scène – culte – de la gare. Pourtant, cette séquence magistrale n’aurait jamais vu le jour sans un affrontement en coulisses entre De Palma et la production. Initialement, le cinéaste souhaitait une poursuite spectaculaire dans un train1 pour rattraper le comptable de Capone, mais le studio refusa pour des raisons budgétaires. Contraint de revoir sa copie, le réalisateur transforma cette frustration en une opportunité : il resserra l’action sur un décor unique et livra l’une des séquences les plus anthologiques du cinéma. Avec des moyens plus limités mais un resserrage de l’espace, il accoucha d’une scène mythique, valant au film d’être régulièrement classé dans les 1001 films à voir avant de mourir.

Pour paraphraser Claude Monnier, le cinéaste affiche clairement ses intentions dès la génèse : « Plus qu’un film de gangsters, il a voulu faire un western, avec tout ce que cela implique de dialectique entre réalité et légende ! » Car, en bon analyste du contrat social, le western de qualité s’est toujours interrogé sur la violence et, plus largement, sur son usage. C’est ce que Peckinpah faisait brillamment. C’est ce que De Palma accomplit ici avec autant de maestria.
Dans Les Incorruptibles, il est avant tout question de parjure pour lutter contre la corruption. Des méthodes à employer face à une violence institutionnalisée. « Avec Capone, y’a pas 36 solutions. Il sort un couteau ? Tu sors un fusil. Il envoie un de tes hommes à l’hôpital ? T’envoies un des siens à la morgue. C’est ça, la loi, à Chicago. » Ces mots, prononcés par Malone (un Sean Connery impérial), résument à la fois le pragmatisme implacable du film et sa dualité fondamentale : la confrontation entre la loi et la force brute. Cette approche sert autant l’action pure que la réflexion sous-jacente sur l’efficacité de la justice face à un empire du crime organisé. L’idée, simple mais terriblement efficace, s’inscrit à la croisée des ambitions du dramaturge David Mamet et du formaliste Brian De Palma. Le sens du cadre du cinéaste, couplé à une caractérisation immédiatement efficiente des personnages, confère une intensité dramatique exceptionnelle à chaque perte humaine. Dans le film, la disparition des protagonistes frappe avec une puissance rare, renforcée par la sublime partition d’Ennio Morricone. La scène de l’ascenseur en est le parfait exemple : un plan-séquence virtuose qui pose à la fois les enjeux et amplifie l’impact émotionnel du drame qui se joue sous nos yeux. Chaque décès dans Les Incorruptibles suit un schéma précis, implacable. Que ce soit Oscar Wallace ou Malone, ils sont filmés dans un plan-séquence où la caméra semble leur accorder un dernier souffle, les laissant vivre un instant… avant le basculement fatal. Le choc est brutal, douloureux, et inscrit donc la violence au cœur du récit. Plus largement, le film repose sur une fascinante dualité. Tout au long du récit, le duo Mamet-De Palma déroule un programme d’un classicisme hollywoodien assumé tout en détournant sans cesse les codes. Là où André Bazin affirmait que le cinéma classique privilégiait « des caméras ne nous donnant que la meilleure vue de l’ensemble », De Palma s’y oppose par son arme la plus fatale… SA caméra. Son style explose à l’écran : plongées et contre-plongées ultra-stylisées brisent toute convention et transforment chaque scène en un exercice de mise en scène saisissant. L’exemple le plus frappant demeure la séquence du procès et la mise à mort de Frank Nitti, modèle absolu de dilatation temporelle et de tension dramatique exacerbée. Avançons avec insistance : s’il y a une scène qui surpasse toutes les autres, c’est bien évidemment celle de la gare. De Palma y orchestre un moment d’anthologie, où chaque élément de mise en scène sert une montée en tension d’une virtuosité hallucinante. Au-delà du clin d’œil au Cuirassé Potemkine d’Eisenstein, la séquence regorge d’idées brillantes. Tout le film semble converger vers cet instant où, à travers une – autre – dilatation temporelle magistrale, De Palma transforme le bruit répétitif des roues de la poussette sur le sol en une métaphore du train-train habituel d’Eliot Ness, avant d’exploser le tout dans un ballet de violence et de chaos entièrement dédié au spectateur. Chaque fraction de l’espace cinématographique est exploitée avec une maîtrise totale. La scène de légende transforme alors l’essai, Les Incorruptibles devient une anomalie fascinante : un film capable de réconcilier le grand public, avide d’un biopic au casting trois étoiles, et les amateurs de De Palma, connaissant parfaitement son goût pour la manipulation du temps et son sens de la mise en scène perverse ainsi que son talent inné pour la virtuosité. Un classique intemporel.
- L’auteur de ces lignes tient à remercier son complice et ami, Mike Öpuvty, qui lui a fait découvrir les détails de cette anecdote. ↩︎